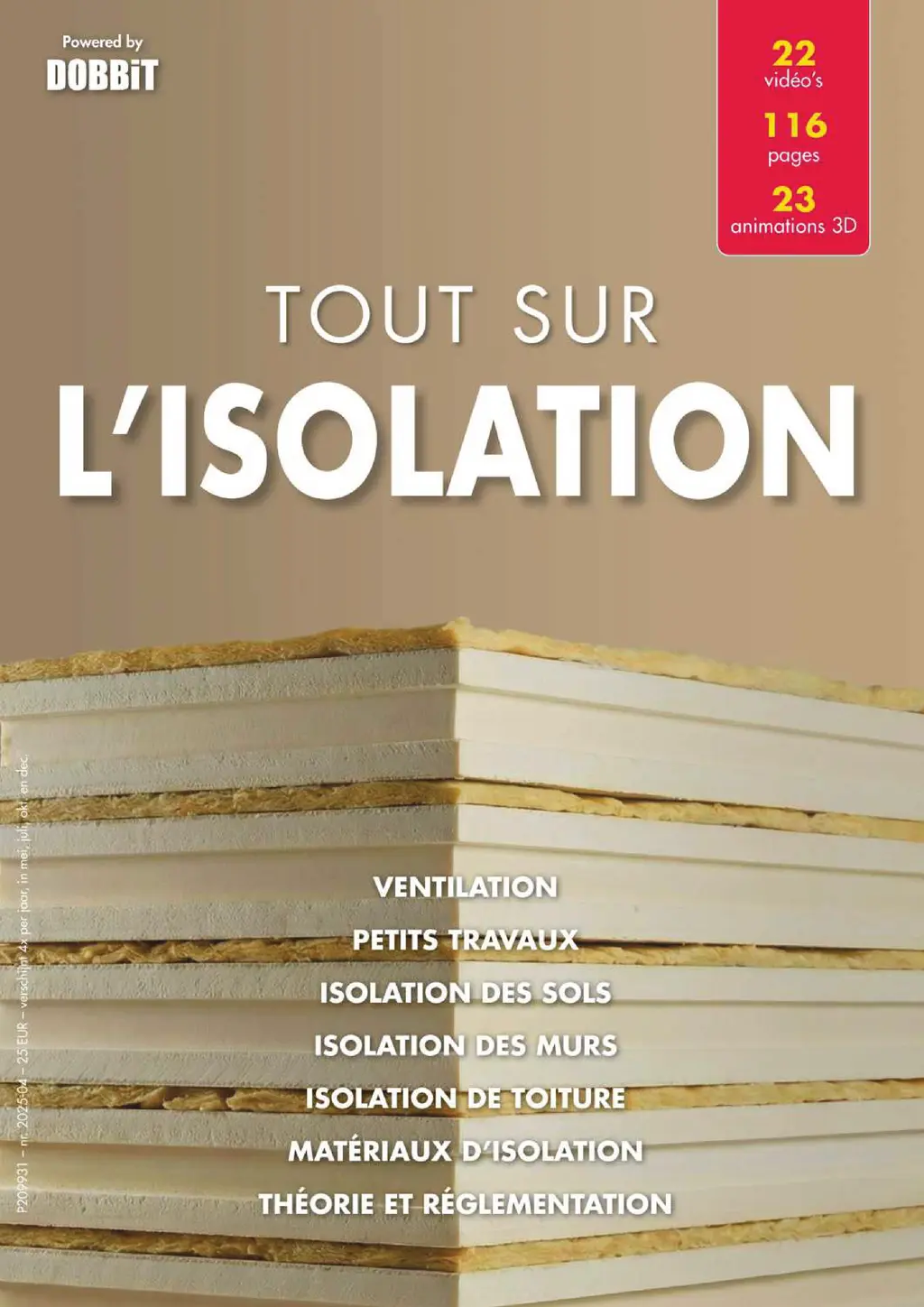"Les plantes indigènes ne sont pas toujours la meilleure solution"
Entretien avec Erik Truyers (Advanta)

Le débat sur l'utilisation de plantes indigènes et de plantes exotiques dans nos écosystèmes fait rage depuis un certain temps. Les partisans des plantes indigènes soulignent l'importance de soutenir la biodiversité locale et de créer des habitats pour la faune indigène. D'autres préconisent une approche plus pragmatique, selon laquelle les espèces exotiques présentant une valeur ajoutée écologique peuvent également avoir leur place. Pour approfondir cette question complexe, GardenPro s'est entretenu avec Erik Truyers, Sales & Product Manager Belgique chez Advanta.
Un concept fourre-tout

"Pouvez-vous me donner une définition claire du terme 'indigène'?" La réponse à cette question apparemment simple s'avère étonnamment complexe. "Il est indéniable que l'on parle beaucoup de la ligne de démarcation entre les indigènes et les exotiques, mais il n'existe pas de définition univoque et généralement acceptée", déclare Truyers. "En fait, on pourrait comparer ce terme au terme 'bio', un autre concept fourre-tout qui n'a pas de définition uniforme, mais avec lequel de nombreuses personnes ont une association concrète. L'interprétation du terme 'indigène' varie beaucoup en fonction du contexte et des personnes qui l'utilisent. Même au sein de la communauté scientifique et des organisations de conservation, il n'y a pas de consensus unanime à ce sujet."
Il illustre la complexité du terme par une anecdote personnelle pertinente. "Mon grand-père mineur a rapporté des fossiles de plantes qui poussaient dans le Limbourg il y a des millions d'années, mais qui ont disparu depuis. Sont-elles donc par définition indigènes? La question se pose: où tracer la frontière entre ce qui est indigène et ce qui ne l'est pas?"
Plus qu'une image instantanée
Compte tenu de la difficulté à définir sans ambiguïté le concept 'indigène', Truyers suggère de porter notre attention sur les processus naturels et autres. "La nature n'est jamais restée immobile. Elle a toujours été en mouvement, bien avant que l'homme ne se sente appelé à intervenir. Le déplacement constant des espèces à travers les ères géologiques - des jungles à nos écosystèmes actuels - l'illustre parfaitement. Le fait de s'accrocher de manière rigide à une image instantanée de ce qui est considéré comme 'indigène' me semble donc être une construction artificielle."
L'évolution récente de notre environnement immédiat confirme son point de vue. La mortalité massive de l'épicéa causée par le bostryche typographe (Ips typographus) et la disparition de l'orme due à des maladies causées par des insectes sont des processus naturels qui mettent en évidence la vulnérabilité de nos espèces supposées 'indigènes'. Le changement climatique joue un rôle important à cet égard, la sécheresse et les conditions météorologiques changeantes exerçant une pression sur l'ordre naturel et entraînant des changements. Nous ne pouvons ni prévoir ni empêcher de tels événements. Malgré toutes les connaissances et les bonnes intentions de l'homme, c'est finalement la nature qui donne le ton. Sa conclusion est donc limpide: "Travaillez avec la nature, ne vous y opposez pas. Vous ne gagnerez jamais cette bataille."

LES ESPÈCES NÉO-INDIGÈNES
Dans le débat sur les plantations indigènes et non indigènes, le terme 'néo-indigène' apparaît de plus en plus souvent. Il s'agit d'espèces qui ont été récemment introduites dans une région, souvent par l'action de l'homme, mais qui se sont établies avec succès et n'ont pas (encore) d'impact négatif sur la nature indigène. Selon Truyens, ce terme est une tentative de nuancer la stricte division entre 'indigène' et 'exotique'.
"Les terme 'néo-indigène' a été créé par l'homme pour faire prendre conscience que le changement est à la fois nécessaire et possible", explique-t-il. Il reconnaît que les espèces se propagent au fil du temps, souvent grâce à l'activité humaine, et que certaines de ces 'nouvelles' espèces peuvent aujourd'hui jouer un rôle précieux dans nos écosystèmes.
Une politique de 'priorité aux autochtones'

Des esprits critiques comme Truyers soulignent la façon radicale dont certains traitent les termes 'indigène' et 'exotique', en adoptant une interprétation stricte et inflexible des listes d'espèces qui doivent être suivies aveuglément. Cependant, un nombre croissant de voix, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur des organisations de protection de la nature, prônent une approche plus pragmatique. "La question centrale qui se pose alors est la suivante: quelles sont les espèces non indigènes qui peuvent être intégrées dans nos écosystèmes de manière responsable sans nuire de manière significative à la biodiversité existante? Les exemples souvent cités dans ce contexte sont le chêne chevelu italien, l'érable de Norvège et le noyer noir. Ces espèces exotiques semblent avoir le potentiel de s'assimiler sans mettre en danger la flore et la faune indigènes."
"Notre obsession de 'pureté' basée sur la provenance semble aveugle aux réalités écologiques"
En outre, le rejet dogmatique de toutes les espèces non indigènes soulève des dilemmes éthiques fondamentaux. Après tout, l'application d'une limite absolue implique une forme d'exclusion biologique, un principe en contradiction avec les valeurs d'inclusion que nous nous efforçons d'atteindre dans la société humaine.Est-il moralement cohérent, dans la nature, d'adopter une politique stricte de 'priorité aux autochtones' à l'égard d'autres formes de vie? Prenons l'exemple du chêne américain, aujourd'hui un citoyen assimilé de nos forêts et de nos parcs, qui fournit abri et nourriture à de nombreuses espèces 'indigènes'. Notre obsession de 'pureté' basée sur la provenance semble aveugle aux réalités écologiques et à la valeur que certaines espèces 'étrangères' ont désormais acquise.
Écologique ou économique
La sélection des mélanges de fleurs, par exemple pour les prairies fleuries, pose un problème similaire. "Parfois, on plaide même pour des espèces indigènes régionales. Bien que je comprenne la philosophie sous-jacente, il m'arrive de remettre en question le raisonnement de manière critique. Ces décisions sont-elles motivées par des intérêts écologiques ou économiques? S'agit-il vraiment de développer la nature ou fait-on prévaloir les intérêts d'une niche commerciale?"

Truyers cite notamment l'exemple des mélanges de fleurs annuelles. Selon plusieurs universités, il s'agit de véritables buffets à volonté pour les insectes, les fournisseurs les plus polyvalents de pollen, ce qui devrait certainement être vital en ces temps de mortalité alarmante des insectes. Pourtant, ces mélanges sont souvent interdits d'utilisation par les gouvernements qui s'obstinent à n'utiliser que des fleurs indigènes. On ignore ainsi de manière flagrante la valeur ajoutée écologique reconnue de ces pollinisateurs. Nous disons qu'il y a un problème, nous avons une solution", soupire Truyers, "mais parce qu'elle n'entre pas dans le moule conservateur 'indigène', elle est exclue." Des entreprises telles qu'Advanta réagissent en proposant des mélanges spécialement conçus pour favoriser les insectes pollinisateurs ET qui peuvent être largement utilisés sur différents types de sols et dans diverses conditions climatiques, sans perturber l'équilibre écologique."
Une approche scientifique
Dans le même temps, Truyers nuance son plaidoyer pour l'ouverture en soulignant la menace réelle que représentent parfois les espèces exotiques envahissantes. "Des espèces comme le cerisier noir et la tristement célèbre renouée du Japon sont des exemples classiques de plantes qui se propagent de manière incontrôlée et causent de graves perturbations dans nos écosystèmes indigènes, au détriment de la biodiversité locale. C'est là que des recherches solides et approfondies et des actions ciblées sont absolument nécessaires", souligne Truyers. Son plaidoyer en faveur d'une approche plus ouverte des espèces non indigènes ne doit donc en aucun cas être considéré comme une autorisation d'introduire de nouvelles plantes au hasard. "Au contraire, je plaide ardemment pour un examen rationnel et scientifique, en recensant soigneusement les risques et les avantages potentiels de chaque espèce."